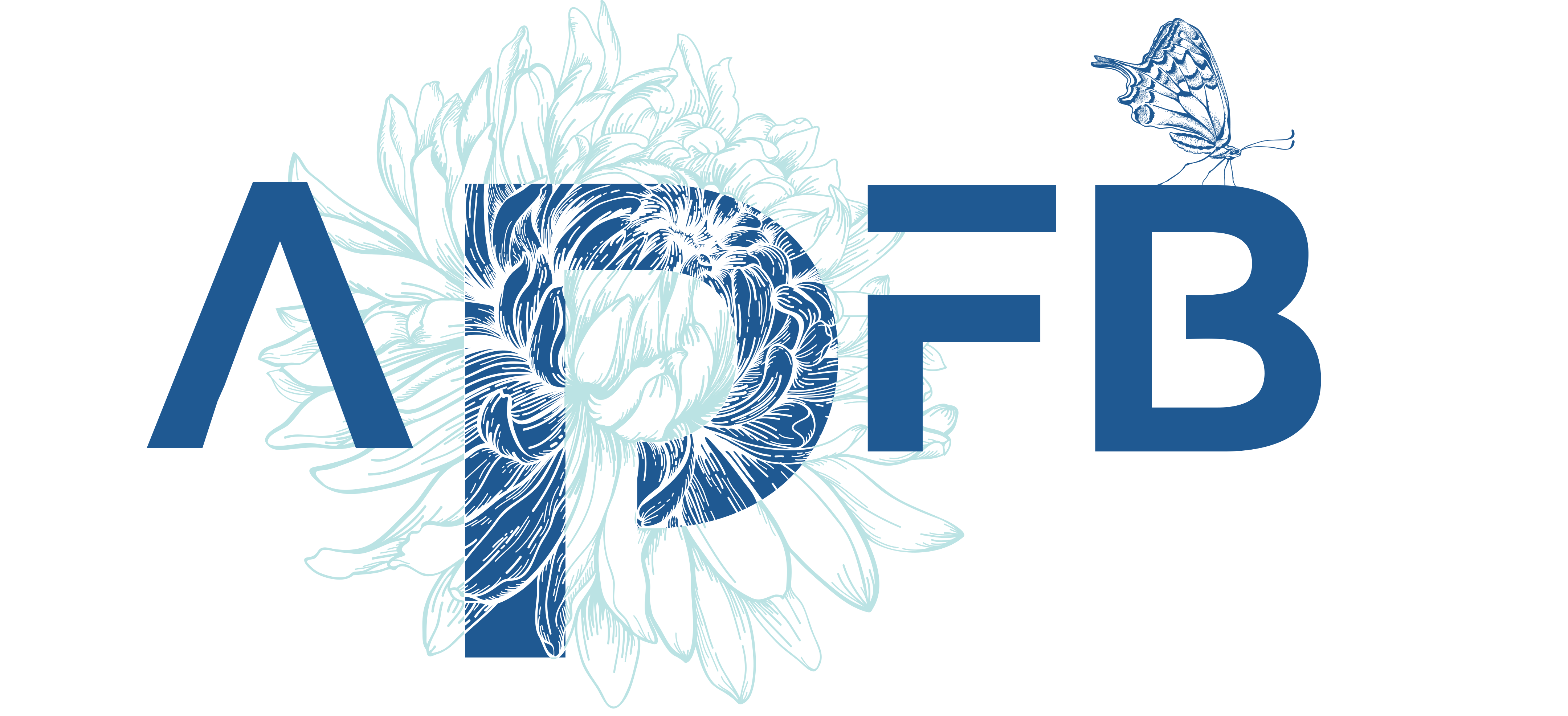Actions Pérennes en Faveur de la Biodiversité
Les parcelles compensatoires
Le projet APFB consiste à sensibiliser aux mesures règlementaires imposées aux structures souhaitant construire ou agrandir un aménagement (hôpital, école, carrière, aire d’autoroute, etc.) et plus particulièrement à la mesure compensatoire.
Comme vous le découvrirez, une parcelle compensatoire est une mesure écologique obligatoire pour pouvoir réaliser un projet. L’aménageur doit mettre des actions en faveur de la biodiversité sur plusieurs années sur des parcelles à l’issue desquelles ces parcelles compensatoires ne sont plus préservées. La question de leur pérennité se pose alors.
Une information pour garder un lien avec la nature et la respecter.
Afin d’identifier ces parcelles, références pour la biodiversité, nous proposons le label APFB sur toutes les communications ERC.
La séquence ERC
Cette séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) est une démarche à la fois d’action préventive et de correction des risques d’atteintes à l’environnement. Elle se met en œuvre en priorité à la source, autrement dit : avant la réalisation du projet ou la mise en œuvre du document de planification qui est la source de ces risques.
Pour ces projets et documents de planification, il s’agit ainsi :
- prioritairement, d’éviter les atteintes prévisibles à l’environnement ;
- à défaut de pouvoir éviter certaines de ces atteintes, d’en réduire la portée ;
- et en dernier recours, de compenser les atteintes qui n’ont pu être ni évitées ni réduites
ERC : comment ?
La séquence ERC est une partie du VNEI, une étude menée par un bureau d’étude spécialisé qui envoie sur le terrain des experts : ornithologue, herpétologue, chiroptérologue, botaniste, entomologiste et généraliste dans la zone du projet d’aménagement à différentes périodes de l’année afin de faire un bilan des enjeux par groupe biologique (oiseaux, insectes etc.) et un relevé des habitats naturels et d’espèces. À l’aide de bibliographies et de connaissances, chaque expert rédige son analyse, photos incluses et fait des préconisations ERC.
Tout le monde peut avoir accès à l’étude VNEI (Volet Naturel d’une Étude d’Impact) qui explique très précisément quels impacts a le projet d’aménagement sur l’environnement concerné par ce dernier. Une lecture parfois fastidieuse mais qui permet de se faire une idée juste entre « pertes » et gains » pour la biodiversité.
Champs d'actions d'un bureau d'études
- Pré-diagnostics et diagnostics écologiques : études permettant un cadrage préalable avec les différents acteurs des projets ;
- Cas par Cas : l’examen au cas par cas permet d’identifier les projets et de déterminer si ils sont susceptibles ou non d’avoir des impacts notables sur l’environnement (dans l’hypothèse, bien évidemment, où ils ne sont pas soumis à une évaluation systématique).
- Volets Naturels d’Etude d’Impact – VNEI : études concernant les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ; études conformes à la réglementation, en application du Code de l’Environnement.
- Evaluations Appropriées des Incidences Natura 2000 : études ciblées sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire ;
- Dossiers de demande de dérogation de destruction d’espèces protégées (faune et flore) : dossiers réglementaires obligatoires en cas de destruction d’espèces et d’habitats d’espèces protégées ; dossier soumis au Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) ;
- Porter à Connaissance, PAC : le « porter à connaissance » désigne la procédure par laquelle le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents le cadre législatif et réglementaire à respecter ainsi que les projets des collectivités territoriales et de l’État en cours d’élaboration ou existants.
- Plan de Gestion sur site de compensation pour la mise en place et le suivi des mesures compensatoires sur 5 ans.
- Elaboration état 0 avant aménagement ou sur parcelles de compensation liées aux projets de création ou d’agrandissement de carrière.
- Accompagnements de chantiers : mission ayant pour but de veiller à l’application des mesures émises lors des études d’impact (intervention pré-travaux de mise en défens, intervention pendant les travaux de suivi du respect des consignes préconisées…) ;
- Aide à la Maîtrise d’Oeuvre (AMO)
- Suivis écologiques : mission après mise en place des installations, et concernant aussi bien la faune et la flore ;
- Conseils et expertises auprès des carriers.
- Caractérisation des zones humides avec relevés floristiques et sondages pédologiques sur site potentiels d’accueil des projets.
ERC : la mesure compensatoire
Une fois les parcelles compensatoires identifiées et acceptées, achetées ou mise à disposition, restent les autres coûts.
Le coût des mesures inclut le coût de mise en œuvre des opérations techniques, le coût de la maîtrise du site, le coût des opérations de gestion, et le coût du suivi de la mise en œuvre. Le coût des opérations de génie écologique, les techniques utilisées, les espèces présentes, l’accès au site, les contraintes de portance du sol, les objectifs des actions, etc. Des milliers d’euros l’hectare, intégrant l’ingénierie, l’investissement et le fonctionnement sur des années (de 5 à 30 ans). Et une fois le « contrat » fini ?
Bureaux d’études, paysagistes, écologues indépendants, entreprises de travaux spécialisées etc. sont les partenaires privilégiés des aménageurs et parfois aussi des agences de communication pour réaliser des outils d’information.
Ces mesures représenteraient près de 170 000 ha de notre territoire soit presque la surface des Bouches-du-Rhône. Compte tenu des informations à ce jour disponibles sur data.gouv.
Sensibilisation et avenir
Un guide a été diffusé par le ministère de la transition écologique en 2021 ( date de la stratégie nationale« Aires protégées 2021-2030 »), à l’intention des acteurs concernés par la mesure de compensation. Est-ce à entendre par là que ces parcelles compensatoires pourraient devenir des aires protégées à la fin du « contrat » ?
Certaines de ces parcelles recèlent de trésors, mais qu’implique la notion d’aire protégée pour ces parcelles ? Qui finance ? Une possible voie pour de la création d’emploi ?
Quelle type d’aire ? faut-il l’inventer ? Leur gestion, comment et par qui ? Sous l’autorité de qui ? etc.
Abandonner ces parcelles une fois « le contrat » arrivé à son terme, contrat qui aura coûté très cher aux aménageurs pour leur gestion, est contraire aux objectifs de la stratégie « Aires protégées 2021 2030 » du gouvernement et potentiellement une aberration écologique.